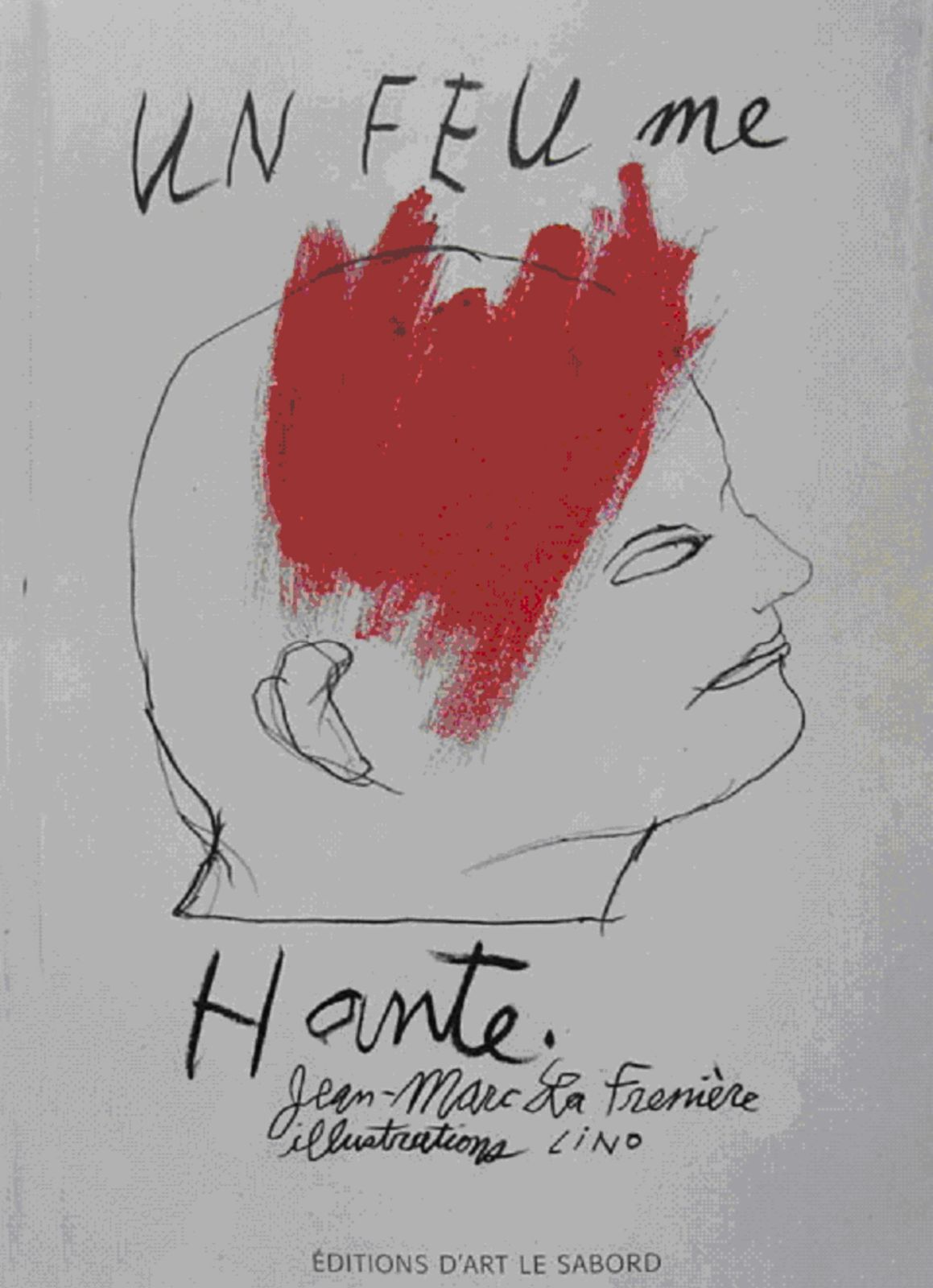Adieu Mozart
Dans la mémoire écaillée de l'homme, Elsa Belle frissonnait au bord de la méditerranée. C’était à Djerba juste avant l’attentat.
Il avait dit : Mona Lisa est un fantôme dérisoire dans la mémoire de tout homme qui connaît ton sourire.
Sur le sable les vagues semblaient rythmer les battements des cœurs.
Ensuite, il y avait eu un bébé, une maison, des amis, un chat et un chien de petite taille qui faisait le beau pour un carré de sucre… enfin il y avait eu tout ce que l’on peut mettre sous un projet de vie et d’amour inscrit au profond de l’espoir.
L’espoir, l’homme y pensait, et là, à cet instant, il se demandait quelle en était la formule : était-ce de croire au futur, de croire aux hommes ou de croire que la bêtise est moins puissante que l’intelligence ?
L’homme se perdait en mille formulations octogonales de l’espoir. Pourtant le jour était jaune.
L’homme ne s’appelait plus, il n’avait plus de nom, il était une image perdue dans un désespérant no man’s land sur les rivières du temps. Le passé était mort. Un vent jaune collait aux vitres de la maison, inquiétant comme ce vide compact où même les solitudes dispersées avaient disparu.
Depuis longtemps les sirènes s’étaient tues. Le nuage jaune était resté là, sur la ville. Les doigts usés, l’homme avait renoncé à appeler les secours. Toutes les voix amies figurant dans son agenda étaient restées silencieuses. Elsa Belle qui, en public détestait ce surnom affectueux, elle non plus, n’avait pas répondu. Inutile de se demander si l’enfant, leur enfant était avec elle, ou s’il était resté emmuré dans un jeu d’écolier. Inutile de se demander si les devoirs étaient faits, il n’y aurait plus d’école.
Rien, plus rien, qu’un vide absolu à poser sur l’insupportable réalité.
Qu’y a-t-il après l’espoir ?
Ce carré blanc sur l’écran d’une télévision ? L’absence des bruits coutumiers, de ces phrases insipides que l’on répète avec agacement : dépêche-toi, tu vas être en retard, n’oublie pas ton goûter ?
Tous ces mots dans la tête de l’homme reprenaient leur musique, partition inachevée. Il n’acceptait rien, il était simplement en panne de désir, une question qui ne voulait pas de réponse.
Il était celui qui pense à l’homme après l’espoir.
Ivre de colère, lui qui n’avait jamais prié, maudissait les savants, les militaires et les politiques. Ceux qui avaient créé la mort propre, celle qui détruit la vie mais laisse intact la matière inerte et les biens matériels.
Seul dans l’univers, il ne se sentait plus homme, il était cette chose pathétique qu’il avait vue en photo : ce désespoir en habit d’homme, ce sourire comme une balafre sur le visage sans visage d'une ombre, yeux collés à la mort, photographiée aux barbelés d’un camp d’extermination. Le sourire de l’ombre, ressemblait au sien. Comme cette ombre, il s’accrochait au devoir de respirer pour aller plus loin, pour savoir si l’ignominie avait une frontière. Mozart allait disparaître avec lui. Mozart allait mourir du silence du monde. Une douleur étrange oppressait son cœur, son ventre et l’essence même de sa pensée. Encore et encore, frénétiquement, il recommença à composer des numéros pris au hasard des annuaires, des numéros de plus en plus distants. À la lettre D, il avait trouvé le nom Dieu, monsieur Li Dieu "Importation de kimonos". Une résurgence d’humour l’avait incité à laisser un message : si monsieur Dieu père ou fils, pouvaient me rappeler, j’en serais très honoré… puis il avait donné son numéro de téléphone. Bien sûr, il n’attendait plus rien. Les seules voix qui répondaient encore étaient des voix de répondeurs orphelins. L’homme s’étonnait : pourquoi, ne pas s’asseoir et être le dernier à avoir écouté Mozart, à savoir ce que mille siècles d’évolution et d’intelligence avaient créé, ce que cinquante ans d’imbécillité avaient détruit ?
Il se demandait quelle était cette rage de vivre qui le poussait à vouloir croire que, quelque part encore, la vie continuerait, alors même qu’il avait franchi toutes les latitudes de l’in-espoir. Son rictus s’élargit lorsqu’il pensa que ces voix magnétiques lui survivraient, qu’inutiles elles traverseraient le temps.
Comme elles, les mondes et tout ce qui était, tout ce qui avait été, n’auraient été que mirage, un éphémère inutile n'ayant trouvé ni sa raison d’être, ni sa raison de disparaître.
Des millions d’années que se posait la question du Grand Mystère : "d’où vient-on, où va-t-on ?", et la question allait disparaître sans réponse.
Pourquoi la musique, pourquoi la poésie et toutes les questions sur tout ce qui fait le sens de la vie. Tout ce que la philosophie avait enseigné devenait dérisoire.
L’homme écoutait Mozart, le buvait avec avidité, conscient que nul après lui, jamais, ne saurait ce que la beauté peut être. L’homme mesurait l’ironie. Il fonctionnait maintenant comme ces automates costumés que l’on envoyait en mission avec un projet de médaille posthume pour le devoir accompli. C’est à lui que revenait l’ultime questionnement et l’ultime non réponse.
La voix de l’homme, s’il avait encore une voix, était devenue rauque avant de s’enrayer dans un étrange discours sur la raison.
Hâtivement il avait ramassé tout ce qu’il avait pu sauver. Parmi l’inventaire inutile des richesses humaines, il y avait ce manuscrit qu’il avait volé - si l’on peut dire cela quand il s’agit de récupérer dans une ville déserte un des trésors de l’humanité - il l’avait mis au mur de son bunker, comme un vulgaire poster, sous le centre de recherche géo spatial.
Assis à même le sol il regardait le dessin de Vinci et écoutait Mozart. Un tressaillement précéda ce qui aurait dû être un soupir, mais qui, immanquablement, se transmutait en un juron laconique : les cons !
Il parlait à Léonard comme l’on parle à un vieil ami. Le disque tournait : écoute, disait-il, écoute, ils ont tué Mozart, il ont tué Lorca. D’un regard circulaire il mesurait le désastre, partout le long des murs, des livres empilés comme des langues arrachées se préparaient au silence de l’humanité.
L’homme avait vidé son âme, avait vidé son cœur, une seule chose maintenant comptait : mettre à l’abri ce qu’il pouvait. Il pensa à Malraux qui, parlant du nazisme, avait dit : "ils ont donné des leçons à l’enfer", puis il s’insurgea contre son infidèle mémoire. Il ne savait pas restituer la forme démoniaquement belle de cette affirmation.
Il tentait maintenant un inventaire de sa mémoire, courait d’un livre à l’autre, l’ouvrait, lisait quelques lignes pour Léonard, jetait encore un S.O.S. téléphonique, puis encore creusait ses souvenirs, essayait d’en extraire une phrase, un vers ou une raison de vivre. Ses mots butaient dans la confusion des sens. Il se contentait de l’approximatif du souvenir. Mais à quoi bon le souvenir, à quoi bon, quand l’enfer prend sa dernière leçon ?
L’homme fonctionnait maintenant comme le dernier soldat d’une guerre qui meurt sans projet de médaille. Il s’était agrippé à l’impossible et à l’inaccomplissable devoir. Mozart, Verlaine, Neruda allaient vraiment mourir. Tous les combats pour la Conscience avaient été vains.
Il pensa en riant que demander à un poisson d’escalader l’Everest n’aurait pas été plus désespéré que sa mission.
Un disque de Mozart entre les mains, l’homme se coucha sur une mémoire écaillée, Elsa Belle frissonnait au bord de la méditerranée et c’était à Djerba avant l’attentat.
L’électrophone tournait.
Mozart mourait.
SF et Fantasy - JMS (à paraître)